Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !

Pour rouler sereinement avec une voiture électrique, il est nécessaire que des bornes de recharge soient mises à votre disposition, et en nombre suffisant. Mais encore faut-il que ces bornes soient conçues de la même manière afin de permettre de recharger toutes les voitures électriques. C’est l’objectif (affiché) du Gouvernement…
Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !
Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.
Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.
Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.
Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées ! © Copyright WebLex – 2016
Se porter caution envers un fournisseur

Le dirigeant d’une société se porte caution des engagements que cette dernière prend auprès d’un fournisseur. Ce dernier, constatant la mise en liquidation de la société, se retourne donc contre le dirigeant pour obtenir les sommes qu’elle devait. En vain semble-t-il, en raison d’un problème purement formel…
Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis !
Une société a acheté divers matériaux auprès d’un de ses fournisseurs qui lui a ouvert un compte de paiement à terme. Mais ne pouvant plus faire face à ses engagements, la société signe une reconnaissance de dettes au fournisseur, lequel réclame également la caution personnelle du gérant.
Ce dernier accepte et consent à se porter caution des engagements de la société. Cette dernière finissant par être malheureusement mise en liquidation judiciaire, le fournisseur se retourne donc contre le gérant pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Le gérant va toutefois lui rétorquer que l’acte de cautionnement qui a été mis en place est nul. Lors de la signature de cet acte, il a reporté la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782,50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte de cautionnement.
Ce que constate effectivement le juge qui ne peut donc conclure qu’à l’annulation de l’acte de cautionnement. Il rappelle au passage que le formalisme des cautions qui doit être obligatoirement respecté vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient le fournisseur dans cette affaire !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422
Se porter caution envers un fournisseur © Copyright WebLex – 2016
Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages !

Si vous envisagez de faire réaliser des travaux visant à améliorer la qualité énergétique de votre logement (isolation, équipements de chauffage, etc.), vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Et en plus de ce coup de pouce fiscal, vous pourrez bénéficier d’un coup de pouce financier…
Cumuler un avantage fiscal et un avantage financier
Si vous réalisez certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (utilisé à titre de résidence principale), du type installation de chaudière à haute performance énergétique, réalisation de travaux d’isolation thermique (fenêtres, volets, murs, toiture, etc.), installation d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, etc., vous bénéficierez d’un crédit d’impôt dont le montant correspond à 30 % du montant des dépenses. Le montant des dépenses prises en compte est toutefois plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge (plafond apprécié sur une période de 5 années).
Bien entendu, cet avantage fiscal suppose de respecter toutes ses conditions d’application : non seulement les travaux, équipements et matériaux doivent respecter des critères techniques très précis (ils viennent encore de faire l’objet de quelques ajustements), mais en outre ils doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE.
En plus de cet avantage fiscal, il est aussi possible de bénéficier d’un avantage financier qui prend la forme d’un prêt à taux 0 pour financer ces travaux (éco-PTZ). Et alors que le cumul de cet éco-PTZ et du crédit d’impôt n’était possible que pour les personnes qui respectaient des conditions de ressources, cette restriction est supprimée. En pratique, ce cumul possible sans conditions de ressources est effectif depuis le 1er mars 2016.
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages ! © Copyright WebLex – 2016
Déclaration d’insaisissabilité : à faire au plus tôt
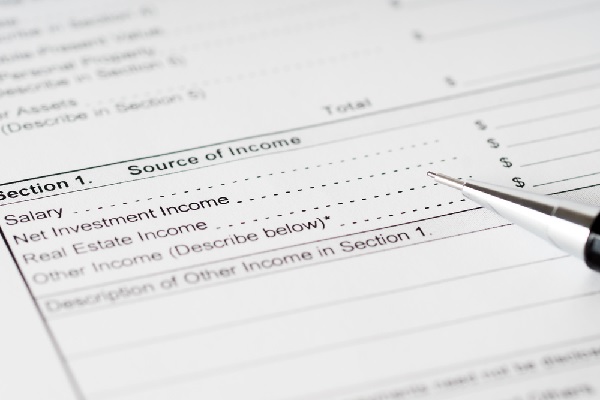
Le mandataire liquidateur d’une personne placée en liquidation judiciaire demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité effectuée par ce dernier soit inopposable à la procédure collective. Pour lui, la déclaration est frauduleuse. Ce que conteste vigoureusement le liquidé…
Déclaration d’insaisissabilité frauduleuse = déclaration inopposable !
En mars 2016, un couple effectue une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger un bien immobilier lui appartenant. En décembre 2016, le mari est placé en liquidation judiciaire. Un mandataire liquidateur est alors nommé par le juge. Il demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité soit inopposable à la procédure collective car il la juge frauduleuse.
Inopposabilité que conteste le mari. Il ne voit pas en quoi est frauduleux le fait de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité.
Le mandataire liquidateur lui explique alors qu’il est frauduleux de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité lorsque la déclaration a pour but de porter préjudice à un créancier futur. Il rappelle que le mari avait rencontré dès 2005 des difficultés financières l’ayant contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux. Pour lui, parce que le mari était en état d’insolvabilité apparente au jour de la déclaration, cette dernière est frauduleuse et doit donc être inopposable.
Inopposabilité que lui accorde le juge : la déclaration d’insaisissabilité a été faite frauduleusement pour porter préjudice aux créanciers futurs. Ces derniers peuvent donc faire valoir leurs créances lors de la procédure collective.
Cette histoire illustre bien qu’il est dans l’intérêt de tout créateur d’entreprise de procéder à la déclaration d’insaisissabilité au plus tôt, sans attendre que les difficultés financières surviennent…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-21876
Déclaration d’insaisissabilité : à faire au plus tôt ! © Copyright WebLex – 2016
Impôts et taxes : du nouveau pour vous en 2017 !

Au-delà de la mise en place du prélèvement à la source programmée pour 2018 (et qui fait l’objet d’un article complet disponible sur notre site), les Lois de Finances contiennent des mesures qui intéressent plus particulièrement les particuliers. Voici un panorama des principales nouveautés fiscales qui vous concernent qu’il est important de connaître, notamment s’agissant des réductions et crédits d’impôt sur le revenu…
Des changements affectent de nombreux avantages fiscaux
De nombreuses mesures intéressent les différents crédits ou réductions dont vous pouvez bénéficier selon la nature de vos investissements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.
• Réduction d’impôt pour souscription au capital des PME
Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’une réduction d’ISF. Pour le bénéfice de ces avantages fiscaux, entre autres conditions, vous devez impérativement conserver les titres reçus en échange de votre apport en capital jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de votre souscription.
Cette condition est assouplie puisqu’il est admis qu’une revente des titres plus de 3 ans après la souscription n’entraîne plus de remise en cause de l’avantage fiscal si :
- vous réinvestissez le produit de la vente des titres dans une société éligible à cette réduction d’IR ou d’ISF,
- vous vous engagez à conserver les titres reçus en échange jusqu’au terme initial de 5 ans.
Notez toutefois que cette nouvelle souscription ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR ou d’ISF.
• Crédit d’impôt lié aux services à la personne
Si vous engagez des dépenses en vue de bénéficier, chez vous, de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux personnes dépendantes, petites travaux, etc.), vous bénéficiez d’un avantage fiscal : un crédit d’impôt si vous exercez une activité professionnelle ou si vous êtes en situation de demandeur d’emploi, une réduction d’impôt si vous n’êtes pas dans ces situations. La différence essentielle réside dans le fait que si l’avantage fiscal est supérieur au montant de votre impôt, vous pourrez obtenir le remboursement de l’excédent uniquement s’il s’agit d’un crédit d’impôt.
A compter de l’imposition des revenus perçus en 2017, il n’est plus fait de distinction : désormais, l’avantage fiscal lié aux dépenses engagées au titre des services à la personne prendra systématiquement la forme d’un crédit d’impôt.
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique et éco-PTZ
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique et prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2017 et son cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources (admis en pratique depuis le 1er mars 2016) est confirmé.
• Crédit d’impôt lié aux primes d’assurance pour loyers impayés
Les bailleurs qui louent des logements conventionnés à des locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent obtenir un crédit d’impôt au titre des primes d’assurance pour loyers impayés qu’ils souscrivent auprès d’une compagnie d’assurance.
Ce crédit d’impôt est supprimé pour les primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
Tout avantage fiscal n’est cependant pas perdu puisque ces primes d’assurance restent déductibles des revenus fonciers imposables.
• Réduction d’impôt Duflot-Pinel
Le dispositif Duflot-Pinel, qui offre une réduction d’impôt aux acquéreurs d’un logement neuf ou assimilé qu’ils s’engagent à louer pendant une certaine durée est prorogé pour un an. Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2016, il est étendu aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est également envisagé d’ouvrir cet avantage fiscal aux investissements immobiliers réalisés dans certaines communes de la zone C qui auront obtenues un agrément en ce sens.
• Réduction d’impôt Besson-ancien et Borloo-ancien remplacées par le dispositif Cosse-ancien
Les dispositifs Besson-ancien et Borloo-ancien permettent d’obtenir une déduction fiscale spéciale appliquée aux revenus fonciers tirés de la location de logements réalisée dans le cadre d’une convention conclue avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Ces dispositifs, qui vont progressivement disparaître, sont remplacés, pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2017, par le dispositif Cosse-ancien. Sous réserve de s’engager à louer le logement à des personnes modestes (des conditions de loyers et de ressources sont à respecter), le bailleur bénéficie d’une déduction fiscale spéciale dont le taux varie de 15 % à 85 % selon le type de location et le lieu de situation du logement.
L’une des nouveautés de ce dispositif consiste à recentrer le dispositif sur les logements situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs (en pratique, il s’agit des zones A, A bis, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif Duflot-Pinel).
• Réduction d’impôt Censi-Bouvard
Le dispositif Censi-Bouvard, qui offre le bénéfice d’une réduction d’impôt, s’applique aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services et des résidences de tourisme classées. Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2016, est prorogée pour un an jusqu’au 31 décembre 2017. v
Mais cette prolongation ne profitera qu’aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services. Les acquisitions de logement situés dans des résidences de tourisme classées, réalisées à compter du 1er janvier 2017, sont désormais exclues du dispositif Censi-Bouvard.
Notez que, pour les résidences de tourisme classées, une nouvelle réduction d’impôt est mise en place, qui vise spécifiquement les dépenses de travaux de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 15 ans situés dans de ce type de résidence. Egale à 4 400 € au maximum (20 % du montant des travaux retenu dans la limite de 22 000 € par logement), cette réduction d’impôt suppose, entre autres conditions, un engagement de location du logement pendant au moins 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
• Réduction d’impôt Malraux
La réduction d’impôt Malraux, qui bénéficie aux investisseurs réalisant des travaux de restauration immobilière de logement destiné à la location dans certains quartiers urbains, fait l’objet de quelques aménagements, et notamment les suivants :
- le plafond annuel de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt, fixé à 100 000 €, est remplacé par un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 400 000 € sur 4 ans ;
- si la réduction d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent peut être imputé sur l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ;
- le non-respect de l’engagement de location ne constitue plus une remise en cause de l’avantage fiscal s’il est dû à une invalidité, un décès ou un licenciement de l’un des membres de couple.
Une incitation fiscale à l’investissement : le compte « PME innovation »
La Loi de Finances rectificative pour 2016 incite les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à réinvestir le produit de cette vente dans des jeunes PME : pour cela vient d’être mis en place le « compte PME innovation » (CPI) à compter du 1er janvier 2017.
Schématiquement, ce CPI, qui s’apparente au PEA, s’organise de la manière suivante :
- vous ouvrez un CPI auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit, donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces ;
- vous y apportez les titres de votre société (en 2017, vous pouvez y apporter les liquidités issues de la vente de titres de votre société intervenue après le 1er janvier 2016) ;
- le produit de la vente ultérieure de vos titres, inscrit sur le compte espèces, devra servir à l’acquisition de titres de jeunes PME, dans un délai de 24 mois à compter de la cession.
L’intérêt de ce CPI est de reporter l’imposition des gains nets réalisées dans le compte au moment de la sortie du compte (les prélèvements sociaux restent toutefois exigibles chaque année).
Ce dispositif est assorti de nombreuses conditions, et notamment les suivantes :
- en ce qui concerne les titres de la société déposés à l’ouverture du CPI : il doit s’agir d’une PME créée depuis moins de 10 ans et exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ;
- en ce qui concerne le titulaire du CPI : il doit, soit détenir ou avoir détenu au moins 25 % de la société, soit exercer ou avoir exercé une fonction de direction ou une activité salariée pendant au moins 24 mois et détenir ou avoir détenu au moins 5 % du capital, soit être signataire d’un pacte d’associés portant sur au moins 25 % du capital (chaque signataire devant détenir au moins 1 % du capital et l’un d’entre eux devant avoir exercé une fonction de direction) ;
- le remploi des fonds issus de la vente doit porter sur l’acquisition de parts de société de capital-risque ou de titres de PME non cotée de moins de 7 ans, soumise à l’IS, dans laquelle le titulaire du CPI n’est pas déjà associé, employant au moins 2 salariés, n’ayant pas déjà reçu plus de 15M€ de levée de fonds, etc.
- le titulaire du CPI doit s’engager à accompagner les sociétés dans lequel il a investi, soit en exerçant une fonction de direction, soit en étant administrateur, soit en signant une convention d’accompagnement et de prestations de services à titre gratuit.
Notez cependant que ce dispositif ne se cumule pas avec les réductions d’impôt pour souscription au capital des PME, l’exonération partielle d’ISF prévu pour les salariés et mandataires sociaux, le dispositif Dutreil.
Autres mesures fiscales à connaître
Voici d’autres mesures fiscales qui méritent d’être signalées :
- les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel ;
- le dispositif du PEA est durci : il est notamment interdit de se vendre à soi-même des titres et de les transférer ensuite vers un PEA (les sommes versées sur un PEA ne peuvent plus être utilisées pour acheter des titres détenus hors du PEA par le titulaire du PEA, et ce depuis le 6 décembre 2016) ;
- la réduction de droits pour charges de famille (égale à 305 € ou 610 € par enfant en sus du deuxième selon les bénéficiaires), jusqu’alors applicable au calcul des droits de succession et de donation, est supprimée à compter du 1er janvier 2017 ;
- les donations faites au profit d’une personne adoptée selon la procédure de l’adoption simple bénéficient du tarif applicable aux donations entre ascendant et descendant.
Il faut enfin préciser que des mesures spécifiques ont été prises s’agissant des plus-values de cessions de titres et plus spécialement les suivantes :
- les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne bénéficient pas des actuels abattements pour durée de détention, mais se voient appliquer un coefficient d’érosion monétaire ;
- le régime de report d’imposition en cas d’apport de titres par une personne physique à une société soumise à l’IS est aménagé.
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Impôts et taxes : du nouveau pour vous en 2017 ! © Copyright WebLex – 2017
Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur

L’acquéreur d’un fonds de commerce est par principe solidaire, avec le vendeur, du paiement des bénéfices réalisés par ce dernier. Par principe, cette solidarité ne s’applique que pendant 90 jours. Un délai qui peut être réduit désormais à 30 jours. Sous quelles conditions ?
Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.
Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)
Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur © Copyright WebLex – 2016
Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € !

Pour renforcer la sécurité et la traçabilité des cartes prépayées et lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, ces cartes sont désormais plafonnées. Quels sont ces montants plafonds ?
Cartes prépayées : des plafonds en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Désormais, le montant des cartes prépayées ne peut être supérieur à 10 000 €. De plus, les opérations de chargement, de retrait ou de remboursement au moyen de ces cartes sont plafonnées à 1 000 € par mois (comprenez mois calendaires s’agissant des chargements et retraits).
Ces nouveaux plafonds s’expliquent par la volonté du Gouvernement d’améliorer la sécurité de ces cartes et de renforcer leur traçabilité afin de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il est apparu, en effet, que ces cartes sont très utilisées par les terroristes.
Source : Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées
Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € ! © Copyright WebLex – 2016
Créateur ou repreneur d’entreprise : pensez à l’ACCRE !
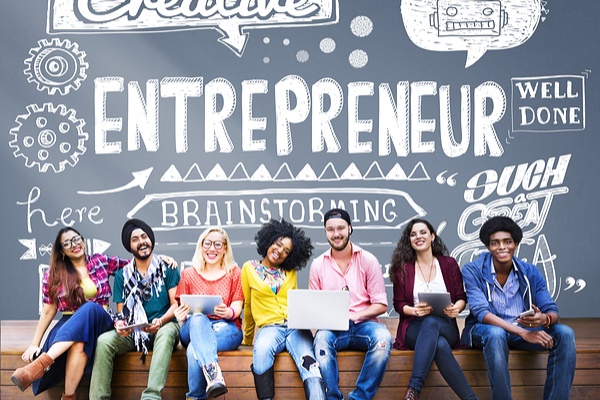
L’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre), qui consiste en une exonération partielle des charges sociales pour une durée d’un an, peut être accordée sous conditions aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise. A compter du 1er janvier 2017, cette exonération devient dégressive.
Accre : l’exonération varie selon le montant des revenus !
Les créateurs et les repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, pendant 1 an, d’une exonération de cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès ainsi que d’une exonération des cotisations d’allocations familiales : il s’agit de l’aide au chômeur créateur ou repreneur d’une entreprise (Accre).
Jusqu’à la fin de l’année 2016, cette exonération était ouverte à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise dans la limite des revenus qui n’excèdent pas 120 % du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exonération s’applique.
En présence d’entreprise créées ou reprises depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de cette exonération peuvent y accéder progressivement, en fonction de leurs revenus :
- l’exonération des cotisations est totale lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur(e) ou égal(e) aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
- au-delà de ce seuil, l’exonération décroît linéairement et devient nulle lorsque le revenu ou la rémunération atteint le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 € en 2017).
Notez que nous sommes dans l’attente d’un décret fixant les modalités de calcul de cette exonération désormais dégressive.
Accre : de nouveaux cas d’attribution !
Jusqu’à présent, les repreneurs d’une entreprise en difficulté ne pouvaient bénéficier de l’Accre que si l’entreprise en question était celle pour laquelle ils travaillaient. Mais cette condition n’a plus cours à compter du 1er janvier 2017 : l’Accre peut donc désormais être accordée au salarié d’une entreprise en difficulté même lorsque cette entreprise n’est pas celle pour laquelle il travaille.
De plus, toujours à compter du 1er janvier 2017, le salarié repreneur d’une entreprise n’est plus tenu d’investir dans le capital de l’entreprise la totalité de l’aide perçue, ni même de réunir des apports en capitaux au moins égaux à la moitié des aides perçues.
L’Accre est également accordée aux personnes qui reprennent (et non plus seulement qui créent) une entreprise située au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV).
Source : Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 6)
Créateur ou repreneur d’entreprise : pensez à l’ACCRE ! © Copyright WebLex – 2017
Loi Sapin 2 : ce qui change en matière d’assurance-vie

La Loi Sapin 2 a modifié la réglementation de l’assurance-vie. Désormais, débloquer l’argent placé sur un compte d’assurance-vie pourrait être moins facile. Pourquoi ?
Assurance-vie : pas de déblocage pendant une crise financière !
S’agissant du portefeuille d’assurance-vie, le Haut Conseil de stabilité financière peut désormais, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en cas de risque pour la stabilité du système financier, recourir à l’une des mesures conservatoires suivantes :
- limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
- restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs du portefeuille ;
- limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
- retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat.
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 3 mois renouvelables hormis la limitation temporaire, pour tout ou partie du portefeuille, du paiement des valeurs de rachat, qui ne peut pas excéder 6 mois consécutifs.
Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 49)
Loi Sapin 2 : ce qui change en matière d’assurance-vie © Copyright WebLex – 2017
Résidences services : pour quels services ?

Une résidence services doit obligatoirement proposer des services spécifiques communs à tous ses occupants. La liste de ces services spécifiques non individualisables vient (enfin) de paraître. Combien y en a-t-il ?
Résidences services : 3 services spécifiques non individualisables !
Une résidence services est un « ensemble d’habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ». La liste de ces services spécifiques non individualisables vient justement de paraître. Elle en comprend 3, à savoir :
- l’accueil personnalité et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
- la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
- le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
Source : Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation
Résidences services : pour quels services ? © Copyright WebLex – 2016
