Une aide financière pour acheter… un vélo électrique !

Vous souhaitez reprendre le sport mais en douceur ? Pensez au vélo électrique ! Il est d’ailleurs possible de bénéficier d’une aide financière pour acheter de tels vélos jusqu’au 31 janvier 2018…
Montant de l’aide financière : 200 € maximum !
Depuis le 19 février 2017, afin de favoriser l’économie « verte », il existe une aide financière pour l’acquisition de vélos électriques qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Cette aide prendra fin le 31 janvier 2018. Le montant de l’aide est de 20 % du coût du vélo. Toutefois, le montant maximal est limité à 200 €.
Pour en bénéficier, il faut acheter un vélo électrique neuf, qui n’est pas équipé de batterie en plomb et qui possède un moteur auxiliaire électrique dont l’alimentation est réduite progressivement et interrompue lorsque vous atteignez la vitesse de 25 km/h. En outre, le vélo ne doit pas être vendu dans l’année qui suit son achat.
Sachez que l’aide peut être directement imputée sur le prix de vente du vélo : dans ce cas, vous n’avez rien à faire. Si tel n’est pas le cas, vous devrez contacter l’Agence de services et de paiement pour être remboursé via le site Internet de l’Agence.
Cette aide peut profiter aussi bien à une entreprise qu’à un particulier. Notez qu’un particulier ne peut en profiter qu’une seule fois, ce qui n’est pas le cas d’une entreprise. De plus, il n’est pas possible de cumuler cette aide avec une autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
Source :
- Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants
- Arrêté du 16 février 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l’aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants
Une aide financière pour acheter… un vélo électrique ! © Copyright WebLex – 2016
Travaux immobiliers : attention au « fait maison »…

Parce que le vendeur a « mutilé » la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple se retourne contre ce dernier, des travaux étant nécessaires pour que la solidité de la maison ne soit plus compromise. Indemnisation que refuse de verser le vendeur, aucun dommage n’étant apparu… A tort ?
Faire des travaux seul, cela peut coûter… très cher !
Ayant des doutes sur la solidité de la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple fait appel à un expert. Ce dernier lui remet un rapport préconisant des travaux. Le couple effectue les travaux et se retourne contre le vendeur, estimant que ce dernier est responsable, au titre de la garantie décennale, de la mauvaise solidité de la charpente.
Le couple rappelle que le vendeur a lui-même modifié la charpente de la maison afin de créer une mezzanine. Or, c’est la création de cette mezzanine et la modification de la charpente qui ont nécessité la réalisation de travaux en urgence : suite aux travaux effectués par le vendeur, le poteau de la cuisine supportait une surcharge concentrée de trente tonnes ! Surcharge pour laquelle le poteau de la cuisine n’avait pas été conçu…
Le vendeur va contester devoir indemniser le couple. Il explique que la surcharge est un « simple risque » de désordres futurs purement hypothétiques. Les désordres n’étant pas encore apparus, il estime qu’il n’a pas à indemniser le couple des travaux effectués pour éviter l’apparition des désordres.
A tort pour le juge ! Ce dernier relève que le vendeur a « mutilé » la charpente, compromettant ainsi la solidité de la maison. Dès lors, les travaux de construction de la mezzanine relevant de la garantie décennale, il est responsable des désordres futurs au titre de la garantie décennale. Il doit donc indemniser le couple pour les travaux effectués afin d’éviter les désordres.
Cette histoire permet de rappeler qu’il est plus qu’opportun, en cas de gros travaux, de faire appel à un artisan du bâtiment qualifié. Le vendeur aurait ainsi pu ne pas « mutiler » la charpente de la maison et il n’aurait pas eu à indemniser le couple…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 15-26505
Travaux immobiliers : attention au « fait maison »… © Copyright WebLex – 2017
La déclaration sociale des indépendants se met à l’heure digitale !

En mai 2017, vous devrez compléter et envoyer votre déclaration sociale des indépendants pour déterminer le montant des cotisations sociales personnelles dues. Certains d’entre vous pourront utiliser le formulaire, d’autres doivent obligatoirement recourir à la télédéclaration en ligne. Et une nouvelle possibilité s’offre aussi à vous…
Déclarez votre DSI via votre smartphone ?
Tous les ans, les travailleurs indépendants (entrepreneurs individuels, gérants de société, etc.) doivent déclarer leurs revenus de l’année passée pour déterminer le montant de leurs cotisations sociales dues et les régularisations qu’il est nécessaire d’effectuer au vu des acomptes versés en cours d’année. Cette obligation prend la forme d’une déclaration sociale des indépendants à compléter en mai de chaque année (nous sommes encore en attente des dates précises pour l’année 2017 à l’heure où nous rédigeons cet article).
Cette déclaration, par définition remplie sur support papier, est toutefois obligatoirement faite par voie dématérialisée (directement en ligne sur le site Internet net-entreprises.fr) pour les professionnels dont les revenus de l’année 2016 ont dépassé 7 845 €.
Le service net-entreprises.fr évolue puisqu’il propose désormais une version mobile disponible sur smartphone et tablette qui permet, uniquement pour les mono-déclarants, de :
- consulter la dernière déclaration saisie,
- saisir et rectifier votre nouvelle déclaration,
- envoyer votre déclaration au RSI,
- profiter des dernières nouveautés de l’application en consultant la simulation des cotisations,
- recevoir par mail un justificatif au format html.
Cette application est disponible sur net-entreprises.fr en cliquant sur les liens suivants :
Source : www.net-entreprises.fr
La déclaration sociale des indépendants se met à l’heure digitale ! © Copyright WebLex – 2017
Assurance-emprunteur : un droit de résiliation… annuel ?

Votée une première fois mais censurée par le Conseil constitutionnel, la disposition prévoyant qu’il est possible de résilier le contrat d’assurance souscrit à l’occasion d’un emprunt immobilier est (enfin) entrée en vigueur. Quelles sont les démarches qu’il faut respecter pour que la résiliation soit effective ?
Crédit immobilier : résilier le contrat d’assurance au bout d’1 an est possible !
Toute personne qui a souscrit un emprunt immobilier, depuis le 23 février 2017, accompagné d’un contrat d’assurance possède désormais un droit de résiliation annuel de ce contrat d’assurance. L’objectif est de permettre à l’emprunteur de changer plus facilement d’assureur et de diminuer le coût de ces contrats.
Pour résilier son contrat, il faut respecter un certain formalisme : l’emprunteur doit envoyer une lettre recommandée avec AR à son assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance.
L’emprunteur devra également par la suite, notifier à son ancien assureur par lettre recommandée avec AR, la décision du nouvel organisme d’assurance qu’il aura choisi et la date de prise d’effet du nouveau contrat d’assurance.
Enfin, sachez que le droit de résiliation annuel bénéficiera à tous les contrats d’assurance souscrits avant le 23 février 2017, à compter du 1er janvier 2018.
Source : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 10)
Assurance-emprunteur : un droit de résiliation… annuel ? © Copyright WebLex – 2017
Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ?
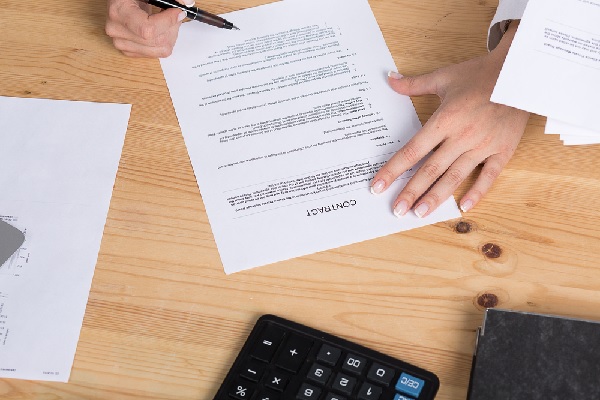
Une personne souhaitant souscrire un prêt doit souvent également conclure un contrat d’assurance-emprunteur mais avec des surprimes lorsqu’elle a eu une maladie grave comme le cancer. Pour lutter contre ces surprimes, un « droit à l’oubli » a été mis en place. Où en est ce dispositif ?
Assurance-emprunteur : un document-type d’information va paraître !
Lorsqu’une personne a eu une grave maladie, elle doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ».
Les pathologies concernées, les délais à compter desquels la maladie est « oubliée », etc., sont listés dans une grille de référence élaborée par la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS.
Sachez que cette Commission a jusqu’au 15 mars 2017 pour proposer un document-type d’information qui devra être remis par les assureurs aux candidats à l’assurance-emprunteur qui ont eu une grave maladie. Ce document précisera :
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
- les modalités de consultation de la grille de référence.
Source : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d’information des candidats à l’assurance-emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ? © Copyright WebLex – 2016
Le port du casque en vélo est-il obligatoire ?

Les personnes circulant en vélo peuvent subir d’importantes blessures lorsqu’elles ont un accident. C’est pourquoi, la réglementation impose le port du casque. Pour tout le monde ?
Pour circuler à vélo, le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans !
A compter du 22 mars 2017, les personnes âgées de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un casque pour circuler en vélo. Mais il ne faut pas porter n’importe quel casque. Il est nécessaire, en effet, qu’il respecte les caractéristiques de casques pour vélo. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que le caque comporte bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par la condamnation au paiement d’une amende de 135 €.
Source :
- Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
- Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
Le port du casque en vélo est-il obligatoire ? © Copyright WebLex – 2016
Défiscalisation Malraux : pas d’avantage fiscal à la revente !

Lorsque la vente d’un bien immobilier est soumise à l’impôt, le gain imposable peut faire l’objet d’optimisations fiscales : minoration « fiscale » du prix de vente, majoration « fiscale » du prix d’acquisition. Encore que cela dépende du bien immobilier en question…
Pas d’optimisation fiscale pour un immeuble « Malraux » !
Lors de la vente d’un bien immobilier, la plus-value immobilière brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Alors que le prix de vente peut être diminué de certains frais, le prix d’acquisition peut être, quant à lui, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise.
Mais cela suppose que ces dépenses de travaux n’aient pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Sont donc ainsi exclues les dépenses de travaux qui ont été déduites des revenus pour le calcul de l’impôt.
C’est justement ce qui vient d’être précisé à propos de la revente d’un bien immobilier placé sous le régime de la défiscalisation Malraux. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, les travaux de restauration immobilière ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour optimiser le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la vente de l’immeuble concerné.
Source : Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771
Défiscalisation Malraux : 1 seul avantage fiscal ! © Copyright WebLex – 2016
Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ?

Un bailleur donne congé à son locataire pour « reprise » afin que son fils habite dans le logement. Le locataire se rendant compte que le fils n’habite finalement pas dans le logement, il demande à son bailleur des dommages-intérêts. Ce que refuse ce dernier : le congé aurait aussi été donné pour « motif légitime et sérieux »…
Un congé doit être délivré pour « reprise » ou pour « motif réel et sérieux » !
Une propriétaire d’une maison mise en location donne congé à sa locataire en lui expliquant qu’il s’agit d’un « congé pour reprise », puisqu’elle veut donner la maison à son fils, comme le lui permet la Loi.
La locataire quitte les lieux. Mais quelques mois plus tard, elle demande le versement de dommages-intérêts, au motif que la maison n’a jamais été habitée par le fils de la propriétaire.
Ce que conteste la propriétaire : elle considère que le congé est tout à fait valable puisqu’au moment de sa délivrance, son fils comptait loger dans la maison. Or, il s’avère que peu de temps après, son fils a appris qu’il était muté, ce qui l’a contraint à renoncer à son projet d’habiter dans la maison de sa mère.
De plus, elle rappelle que dans la lettre de congé, elle mentionnait très clairement qu’elle souhaitait réaliser des travaux dans la maison, travaux impliquant la libération des lieux. Or, pour elle, la réalisation des travaux est un « congé pour motif légitime et sérieux », autorisé par la Loi. Selon elle, le congé est donc valable dans tous les cas.
Arguments qui ne vont pas convaincre le juge, et ce pour plusieurs raisons :
- le congé délivré l’a été expressément « pour reprise » et non « pour motif légitime et sérieux ;
- le fils de la propriétaire n’a jamais habité la maison ;
- après les travaux, la propriétaire a proposé la maison en location à plusieurs personnes, y compris son ex-locataire moyennant un loyer augmenté.
La propriétaire doit donc indemniser son ex-locataire pour le préjudice subi (10 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440
Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ? © Copyright WebLex – 2016
Cession de fonds de commerce : l’acquéreur doit être (bien) informé

L’acquéreur d’un fonds de commerce demande à être indemnisé par le notaire qui a rédigé l’acte de cession du fonds cédé. Motif ? Le notaire ne l’aurait pas suffisamment informé de la situation financière de l’activité cédée. Ce que conteste ce dernier…
La remise des documents comptables légaux est-elle suffisante ?
Après avoir acheté un fonds de commerce, un acquéreur se rend compte que ce fonds a connu une diminution importante de son chiffre d’affaires. Mécontent, il se retourne alors contre le notaire qui a rédigé l’acte de cession du fonds de commerce, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’information.
Le notaire n’est pas d’accord : il rappelle que l’acquéreur a reçu des documents comptables relatifs aux 3 derniers exercices clos et qu’il a visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur.
Mais l’acquéreur considère que les documents remis ne lui permettaient pas de se rendre compte de la diminution du chiffre d’affaires survenue dans les 10 mois précédant la vente du fonds de commerce. Il reproche au notaire un manquement à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur l’insuffisance des éléments comptables mis à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.
« Pas de faute » tranche le juge. Parce que l’acquéreur a eu connaissance du chiffre d’affaires et des bénéfices commerciaux pour les 3 derniers exercices clos, parce qu’il a également visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur, le notaire n’a pas commis de faute. De plus, il relève que l’acquéreur a eu en sa possession des documents comptables récents, et notamment un document prévisionnel portant justement sur les 10 mois ayant précédé la vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 16-10607
Cession de fonds de commerce : l’acquéreur doit être (bien) informé ! © Copyright WebLex – 2016
Don d’organes : que prévoit la réglementation ?

Lorsqu’un proche décède, il peut arriver que se pose la question des dons d’organes. Malheureusement, il arrive souvent que la famille ne soit pas au courant des volontés du défunt. Dans ce cas, ce dernier est-il présumé être un donneur d’organes ?
Par principe, tout le monde est donneur d’organes !
Aux termes de la Loi, tout le monde est présumé consentant au prélèvement de ses organes à son décès.
Pour mémoire, le don d’organes est un acte de générosité gratuit. De plus, si vous êtes donneur, votre nom ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Toutefois, votre famille peut être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande (mais elle ne connaîtra pas l’identité du receveur).
Pour refuser de donner vos organes, vous devez exprimer votre refus de votre vivant. Pour cela, vous devez :
- soit vous rendre sur le site « www.registrenationaldesrefus.fr » ;
- soit rédiger un document écrit (daté et signé) exprimant son refus (en cas d’impossibilité de réaliser vous-même l’écrit, le document peut être rédigé par un tiers dont le contenu est attesté par 2 témoins).
Notez que vous pouvez toujours exprimer le refus du prélèvement de vos organes par oral. Néanmoins, il est déconseillé de se contenter d’exprimer son refus oralement pour des questions de preuves et pour soulager vos proches dans un moment de deuil.
Source : www.registrenationaldesrefus.fr
Don d’organes : que prévoit la réglementation ? © Copyright WebLex – 2016
