Vis ma vie… de syndic immobilier !

L’activité de syndic immobilier n’est pas tous les jours simple : la gestion d’un immeuble demande, en effet, de trouver un accord entre plusieurs copropriétaires, ce qui peut parfois être difficile. Voici 3 exemples qui vous permettront sous doute d’optimiser votre gestion d’immeuble en copropriété…
Syndic immobilier : attention aux copropriétaires indélicats !
Un syndicat des copropriétaires se plaint qu’un copropriétaire ait annexé les combles, qui sont des parties communes de la copropriété, et ce sans autorisation. Ce que conteste le copropriétaire : il rappelle qu’aux termes du règlement de copropriété, les parties communes comprennent le gros œuvre des planchers. Or, son appartement est séparé des combles par un simple plafond de plâtre et non par du gros œuvre. Dès lors, il considère que son appartement et les combles font partie d’un même ensemble constituant son lot de copropriété.
« Faux » répond le syndicat des copropriétaires : si le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent le gros œuvre des planchers, il reste, selon lui, muet sur la nature des combles. Il est donc nécessaire, selon le syndicat des copropriétaires, de se référer à l’état descriptif de division (EDD). Or, celui-ci ne mentionne pas que l’appartement du copropriétaire ait accès aux combles.
De plus, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’avant les travaux effectués par le copropriétaire pour annexer les combles, ceux-ci étaient d’un seul tenant et accessibles seulement par une trappe située dans la cage d’escalier de l’immeuble qui est une partie commune.
Tous ces éléments amènent le juge à considérer que le copropriétaire s’est approprié sans autorisation des parties communes. Le copropriétaire doit donc remettre les combles en l’état où ils se trouvaient avant qu’il ne se les approprie.
Syndic immobilier : attention aux vices de construction !
Un copropriétaire se plaint d’infiltrations dans son appartement. Après expertise, il est révélé que des travaux sont nécessaires dans les parties communes de l’immeuble. Le copropriétaire demande donc au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux nécessaires et de l’indemniser pour les dégâts occasionnés dans son appartement.
Ce que le syndicat des copropriétaires refuse : il rappelle que les infiltrations sont causées par un vice de construction qui n’est pas de son fait. Dès lors, il n’a pas à indemniser le copropriétaire. En outre, il n’a pas à assumer seul, estime-t-il, la charge des travaux de réparation puisqu’une partie des travaux doit être exécutée sur la ruelle attenante à l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires considère donc qu’il n’est pas en capacité de réaliser ces travaux sur la ruelle qui ne lui appartient pas.
Le juge condamne cependant le syndicat des copropriétaires à indemniser totalement le copropriétaire victime des infiltrations, car même si le vice de construction n’est pas de son fait, il en est responsable. Par contre, le juge donne raison au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les travaux devant être effectués dans la ruelle : ce n’est pas à lui de les faire exécuter puisque la ruelle appartient au domaine public, et plus précisément à la commune.
Syndic immobilier : attention aux mauvaises conceptions !
Un copropriétaire est victime de fuites d’eaux dans son appartement situé au 1er étage. Ces fuites d’eaux provoquent des dégâts dans le commerce qui est situé en-dessous, dégâts suffisamment importants pour que le commerçant finisse par ne plus pouvoir exploiter son activité. Le commerçant réclame alors au syndicat des copropriétaires et au copropriétaire possédant l’appartement situé au-dessus de son local professionnel une indemnisation pour le préjudice subi (pertes financières et perte du fonds de commerce).
Ce que refuse le syndicat des copropriétaires : il rappelle que le dégât des eaux provient d’un vice de construction trouvant son origine dans les parties privatives de l’immeuble. Il estime donc que le dirigeant doit seulement réclamer des comptes au copropriétaire possédant le lot qui comprend un vice de construction…
… à tort selon le commerçant : si le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des vices de construction affectant les parties privatives, ce dernier a toutefois commis une faute en laissant subsister un réseau collecteur commun en sous-sol qui présente des contre-pentes favorisant le débordement de l’eau non évacuée au 1er étage. Ce qui a fini par arriver dans l’appartement du copropriétaire situé au-dessus du commerce du dirigeant…
Argument qui va convaincre le juge ! Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à indemniser le dirigeant, sa responsabilité étant retenu à hauteur de 80 %, les 20 % restant étant à la charge du copropriétaire.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-18908
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-19571
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-17825
Vis ma vie… de syndic immobilier ! © Copyright WebLex – 2017
Indemnité de congés payés : quelles rémunérations prendre en compte ?

L’indemnité de congés payés se calcule, par principe, sur la base des éléments de rémunérations perçues en contrepartie du travail effectué par le salarié. Un principe qui n’est pas toujours simple d’application, surtout si des primes et indemnités sont versées au salarié. En voici un exemple…
Prime d’ancienneté : incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés ?
Tout d’abord, rappelons que pour calculer l’indemnité de congés payés, il faut tenir compte du salaire proprement dit et de tous les autres éléments accessoires qui ont le caractère d’une rémunération, et seulement ceux-ci (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Cela signifie donc qu’il faut tenir compte des primes et indemnités qui sont la contrepartie du travail effectif du salarié. A contrario, il ne faut pas tenir compte des primes et indemnités qui rémunèreraient à la fois des périodes de travail effectif et des périodes de congés (ce qui reviendrait à les verser 2 fois pour la période de congés).
L’application de cette règle n’est pas aussi simple en pratique, comme le démontre cet exemple.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié réclame le paiement d’une indemnité complémentaire au titre des congés payés : il estime que, pour calculer l’indemnité compensatrice de congés payés, il faut tenir compte de sa prime d’ancienneté. Ce que conteste l’employeur qui estime que la prime d’ancienneté ne rémunère pas un travail effectif, l’excluant ainsi de ce calcul.
Mais le juge rappelle que l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. De ce fait, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, comme c’est le cas des primes d’ancienneté.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-16643
Indemnité de congés payés : quelles rémunérations prendre en compte ? © Copyright WebLex – 2017
Ouverture dominicale des commerces de détail : une condition reportée ?

En 2015, de nouvelles règles se sont imposées aux commerces de détail pour ouvrir le dimanche, dérogeant ainsi à la règle du repos dominical. Il s’agissait pour ces entreprises de conclure un accord collectif avant le 1er août 2017. Mais beaucoup d’entre elles ont pris du retard…
Un report d’une année…
Les entreprises situées en zones commerciales (correspondant aux anciens périmètres d’usage de consommation exceptionnelle – PUCE) doivent, pour ouvrir le dimanche, être couvertes par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial. Il doit prévoir des contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Avant 2015, le travail dominical était possible s’il était prévu par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur. Les entreprises concernées par l’ancienne règlementation n’avaient que jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (et valider un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Mais la date a été reportée d’un an : elles ont donc jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord, ou, pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour proposer un référendum sur le sujet.
Dans les zones touristiques (correspondant aux anciennes zones touristiques ou thermales ou d’animation culturelle permanente), l’ancienne règlementation n’imposait pas à l’accord collectif permettant le travail dominical de prévoir des contreparties pour les salariés. Les entreprises concernées avaient donc jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (via la mise en place d’un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Là encore, le délai est reporté d’un an.
Source : Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 7
Ouverture dominicale des commerces de détail : une condition reportée ? © Copyright WebLex – 2017
Ordonnances Macron : des nouveautés pour les formes spécifiques de travail

La réforme du Code du travail engagée par le Gouvernement apporte un grand nombre de nouveautés. Certaines formes spécifiques de travail n’y échappent donc pas. Voici celles qui concernent le CDD et l’intérim, le télétravail, le CDI de chantier (ou d’opération) et le prêt de main d’œuvre à but non lucratif …
Spécificité du CDD et de l’intérim
Jusqu’à présent, lorsque vous embauchiez un salarié en CDD ou lorsque vous recouriez à l’intérim, vous ne disposiez que d’un délai de 2 jours pour transmettre le contrat de travail au salarié, sous peine d’une requalification du CDD ou du contrat de mission en CDI.
Depuis le 24 septembre 2017, le défaut de transmission du contrat dans ce délai ne donnera plus, à lui seul, lieu à la requalification du contrat en CDI, mais ouvrira droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié.
Notez, pour information, que la durée maximale (de 18 mois) du CDD ou de la mission d’intérim ou encore le nombre de renouvellements (fixé à 2) pourront être aménagés par un accord de branche.
Télétravail
L’employeur peut mettre en place le télétravail par accord collectif, ou à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée après avis de la nouvelle instance représentative du personnel (le comité social et économique), si elle existe.
Tout salarié qui occupe un poste éligible au télétravail, conformément à l’accord collectif ou à la charte, peut, à sa convenance, demander à bénéficier de cette organisation de travail. Si l’employeur refuse, il doit motiver sa réponse.
Concernant le recours occasionnel au télétravail, aucun formalisme n’est exigé, mais il doit résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié. L’écrit est donc préférable pour prouver l’existence d’un tel accord.
Ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus à partir du 24 septembre 2017. Néanmoins, lorsque les clauses de l’accord collectif ou de la charte sont contraires aux clauses d’un contrat de travail conclu avant cette date, le salarié peut refuser l’application de l’accord ou de la charte. Pour cela, il dispose d’un délai d’1 mois à partir de la communication faite dans l’entreprise sur l’existence d’un tel accord ou d’une telle charte.
CDI de chantier ou d’opération
Le CDI de chantier, ou d’opération, est un contrat à durée indéterminée, conclu pour la durée d’un(e) ou plusieurs chantiers/opérations déterminés et non pas seulement pour la durée de l’intervention du salarié.
La loi reconnaît désormais que ce type de contrat peut être conclu, à la fois, dans les entreprises où il est d’usage d’y recourir au 1er janvier 2017 (dans le secteur du bâtiment notamment) et dans les entreprises soumises à une convention collective ou un accord collectif de branche qui le prévoit.
Dans ce cas, l’accord collectif de branche pourra fixer un certain nombre de conditions pour y recourir, notamment la taille des entreprises concernées, leur activité, etc. Mais il devra prévoir les modalités de rupture adaptées à une fin de chantier anticipée ou à l’impossibilité de réaliser le chantier concerné.
Ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus à partir du 24 septembre 2017.
Prêt de main d’œuvre à but non lucratif
Les entreprises ou groupes qui emploient au moins 5 000 salariés peuvent mettre à disposition des collaborateurs, pour une durée de 2 ans maximum, à une jeune entreprise de moins de 8 ans d’existence ou à une PME de 250 salariés au maximum. L’objectif de cette mise à disposition vise à permettre à cette petite/jeune entreprise d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Notez que cette possibilité n’est toutefois pas offerte aux entreprises appartenant au même groupe.
Pour être applicable, ce dispositif nécessite la publication d’un Décret, non encore paru.
Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 4 et 21 à 33
Ordonnances Macron : des nouveautés pour les formes spécifiques de travail © Copyright WebLex – 2017
Généalogistes : pas de contrat de révélation, pas de rémunération !
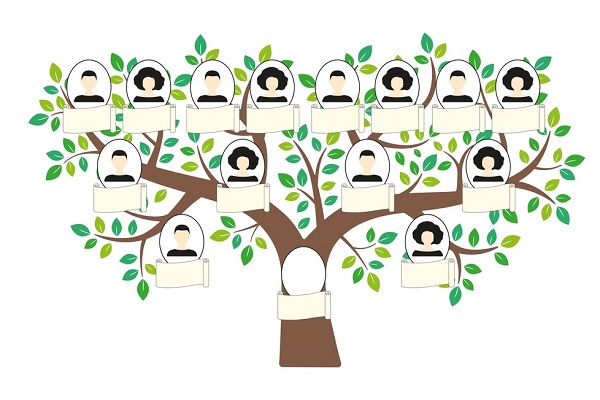
Un héritier identifié par une étude généalogique doit conclure un contrat de révélation pour découvrir de qui il est le successeur. En échange, l’étude généalogique va réclamer une partie de l’héritage. Ce qui peut pousser certains héritiers à tenter de rechercher par eux-mêmes de qui ils héritent…
Généalogistes : pour être rémunérés, il faut avoir révélé l’identité du défunt !
Une défunte, dont il est chargé de régler la succession, n’ayant pas d’héritiers connus, un notaire fait appel à une étude généalogique pour retrouver d’éventuels héritiers. A force de recherches, l’étude généalogique finit par identifier l’héritière de la défunte. Comme le prévoit la pratique, cette étude généalogique la contacte par écrit et lui propose de conclure un contrat de révélation qui informe l’héritière de ses droits successoraux sans toutefois l’informer de l’identité du défunt. En échange de la révélation, 30 % du patrimoine de la défunte doivent revenir à l’étude généalogique.
Mais l’héritière répond par la négative à l’étude généalogique, après plusieurs mois de silence. L’étude généalogique apprend alors, par la suite, que l’héritière a directement contacté le notaire afin de faire valoir ses droits. Mécontente, l’étude généalogique réclame 30 % de sa part d’héritage, estimant que c’est grâce à elle que l’héritière a pris connaissance de sa vocation successorale.
Ce que conteste l’héritière : elle prétend avoir eu connaissance de ses droits successoraux grâce à une connaissance et non par le courrier de l’étude généalogique qui, le rappelle-t-elle, ne mentionne ni l’identité de la défunte, ni celle du notaire. Par conséquent, elle estime que l’étude généalogique ne peut pas lui réclamer 30 % de l’héritage de la défunte.
Ce que confirme le juge : la lettre envoyée par l’étude généalogique n’a pas été utile à l’héritière pour découvrir sa vocation successorale. L’étude généalogique n’a donc pas droit à 30 % de la part d’héritage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-21412
Généalogistes : pas de contrat de révélation, pas de rémunération ! © Copyright WebLex – 2017
Ordonnances Macron : vers une sécurisation des licenciements !

La réforme du Code du travail engagée par le Gouvernement s’inscrit dans un objectif de sécurisation « des relations de travail » et de la rupture des contrats de travail : un délai d’action devant le Conseil des Prud’hommes raccourci, des indemnités encadrées, etc. Voici un panorama des nouvelles mesures.
Un seul délai de contestation !
Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié souhaitait contester la rupture de son contrat de travail, il pouvait agir dans les 2 ans qui suivaient la notification de la décision. Ce délai est désormais raccourci à 12 mois. Ce nouveau délai s’applique donc aux prescriptions en cours, c’est-à-dire qu’il s’applique aux ruptures encore susceptibles de contestation, qui ont donc moins de 2 ans.
Plafonnement des indemnités prud’homales
Jusqu’à présent, lorsqu’un licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroyait au salarié une indemnité qui ne pouvait pas être inférieure à 6 mois de salaire. Mais elle pouvait être bien supérieure !
Désormais, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, les indemnités allouées sont encadrées par un nouveau seuil et surtout un plafond ! Aussi, lorsqu’un licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges accorderont au salarié concerné une indemnité qui dépendra, à la fois de la taille de son entreprise et de son ancienneté dans l’entreprise selon le tableau suivant :
|
Ancienneté du salarié (en années complètes) |
Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|
|
Entreprises employant moins de 11 salariés |
Entreprises employant au moins 11 salariés
|
||
|
0 |
– |
1 |
|
|
1 |
0,5 |
1 |
2 |
|
2 |
0,5 |
3 |
3,5 |
|
3 |
1 |
3 |
4 |
|
4 |
1 |
3 |
5 |
|
5 |
1,5 |
3 |
6 |
|
6 |
1,5 |
3 |
7 |
|
7 |
2 |
3 |
8 |
|
8 |
2 |
3 |
8 |
|
9 |
2,5 |
3 |
9 |
|
10 |
2,5 |
3 |
10 |
|
11 |
3 |
10,5 |
|
|
12 |
3 |
11 |
|
|
13 |
3 |
11,5 |
|
|
14 |
3 |
12 |
|
|
15 |
3 |
13 |
|
|
16 |
3 |
13,5 |
|
|
17 |
3 |
14 |
|
|
18 |
3 |
14,5 |
|
|
19 |
3 |
15 |
|
|
20 |
3 |
15,5 |
|
|
21 |
3 |
16 |
|
|
22 |
3 |
16,5 |
|
|
23 |
3 |
17 |
|
|
24 |
3 |
17,5 |
|
|
25 |
3 |
18 |
|
|
26 |
3 |
18,5 |
|
|
27 |
3 |
19 |
|
|
28 |
3 |
19,5 |
|
|
29 |
3 |
20 |
|
|
30 ou plus |
3 |
20 |
|
Le juge pourra tenir compte des éventuelles indemnités de licenciement qui auront été préalablement versées au salarié.
En cas de licenciement nul ou prononcé en violation d’une liberté fondamentale, l’indemnité allouée au salarié ne pourra pas être inférieure à 6 mois de salaire. Les licenciements visés sont ceux :
- afférant à un harcèlement moral ou sexuel ;
- qui sont discriminatoires ;
- consécutifs à une action en justice relative à l’égalité hommes/femmes ;
- qui sont liés à la dénonciation de crimes ou de délits ;
- qui sont liés à l’exercice du mandat d’un salarié protégé ;
- qui sont prononcés en dépit d’une protection particulière résultant :
- ○ de la maternité ou de la paternité du salarié ;
- ○ d’un accident de travail ou une maladie professionnelle du salarié.
Ce barème est, somme toute, assez proche du barème indicatif que les juges pouvaient déjà appliquer depuis novembre 2016.
Spécificité du licenciement économique
Les indemnités relatives à ce nouveau barème peuvent se cumuler, dans la limite des plafonds fixés, avec les indemnités versées en cas d’irrégularité du licenciement économique :
- l’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel ou d’information du licenciement (qui dépend du préjudice subi par le salarié) ;
- l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche (qui sera d’au moins 1 mois de salaire au lieu de 2) ;
- l’indemnité pour défaut de mise en place des représentants du personnel sans procès-verbal de carence (qui est au minimum d’1 mois de salaire).
De même, lorsque en cas de nullité de la procédure de licenciement, le salarié pouvait prétendre à une indemnité minimale de 12 mois de salaire. Cette indemnité sera désormais équivalente à 6 mois de salaire au minimum.
Désormais, les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, lorsqu’elles peuvent motiver un ou des licenciement(s), s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient lorsque ces entreprises sont établies sur le territoire national (sauf en cas de fraude).
Le secteur d’activité se caractérise, notamment, par la nature des produits, des biens ou des services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Ces dispositions s’appliquent aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017.
Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 2, 3, 5, 6, 15 et 39
Ordonnances Macron : vers une sécurisation des licenciements ! © Copyright WebLex – 2017
Revenir sur une rupture de période d’essai : (im)possible ?

Une entreprise rompt la période d’essai d’un salarié puis finalement se ravise. Elle lui écrit donc qu’elle annule la rupture prononcée quelques jours plus tôt. Mais plus tard, alors qu’elle a finalement licencié ce salarié, celui-ci prétend que son contrat a été abusivement rompu au cours de la période d’essai…
Travail après la rupture de la période d’essai = annulation de la rupture
En novembre, une entreprise industrielle engage un directeur marketing avec une période d’essai de 3 mois. Souhaitant lever un doute sur les compétences de ce nouveau salarié, l’employeur lui adresse un courrier l’informant du renouvellement de la période d’essai pour une nouvelle période de 3 mois, en février. Puis, en avril, il lui notifie la rupture de sa période d’essai.
Mais il se ravise et lui écrit, la semaine suivante, qu’il annule la rupture envisagée. Finalement, 7 mois après l’embauche, en juin, l’employeur licencie le salarié pour faute. Licenciement que ce dernier conteste au motif que l’employeur ne peut pas revenir sur une rupture de la période d’essai qu’il a prononcée sans l’accord du salarié concerné…
… Accord qu’il a donné tacitement, précise le juge : en continuant de travailler après l’expiration du préavis mentionné dans la lettre du mois d’avril, le salarié a accepté l’annulation de la rupture de la période d’essai. Le contrat n’a donc pas été rompu à ce moment-là.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n° 16-15446
Revenir sur une rupture de période d’essai : (im)possible ? © Copyright WebLex – 2017
Engagement de caution : quand la banque commet une erreur…

Caution des engagements souscrits par la SCI dont il est associé, un dirigeant est sollicité par la banque pour obtenir le remboursement de l’emprunt octroyé à sa société. Ce qu’il refuse en opposant 2 arguments à la banque. L’un à raison, l’autre à tort…
Engagement de caution du dirigeant : à ne pas négliger !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt professionnel souscrit par une SCI dont il est associé. Mais quelques années plus tard, la SCI n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : il rappelle que la banque a attendu 4 ans avant d’engager une action à son encontre. Or, l’action d’une banque contre un particulier se prescrit par 2 ans. L’action de la banque à son égard est donc, pour lui, irrecevable car tardive…
… à tort selon le juge ! Le prêt souscrit par la SCI avait un caractère professionnel. Or, l’action d’une banque contre un professionnel se prescrit par 5 ans. Rappelant le principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel », la banque a donc 5 ans pour agir contre le dirigeant. Comme elle a agi au bout de 4 ans, son action est recevable.
Si l’action de la banque à son égard est recevable, le dirigeant explique alors qu’il n’est pas tenu de verser les intérêts échus. Il rappelle alors le principe suivant : la banque qui a accordé un emprunt à une société, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque ne peut pas réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû informer la caution.
Or, le dirigeant prétend qu’il n’a pas reçu cette information annuelle. Dès lors, la banque ne peut pas lui réclamer les intérêts échus. Ce que conteste formellement la banque : pour le prouver, elle produit la copie des 6 dernières lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à la caution.
Ce qui est insuffisant, toutefois, pour prouver que les lettres d’information ont effectivement été envoyées et reçues par la caution, estime le juge, qui donne raison, sur ce point, au dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258
Engagement de caution : quand la banque commet une erreur… © Copyright WebLex – 2017
Licenciement et indemnité : quelles rémunérations prendre en compte ?

Une entreprise industrielle, en grande difficulté économique, établit un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement supérieure à ce que prévoient la Loi et sa convention collective. Une salariée, licenciée pour motif économique, va pourtant contester cette indemnité, estimant que toutes ses rémunérations n’ont pas été prises en compte…
Rémunération = tout versement soumis aux charges sociales ?
Une entreprise de production de produits d’hygiène envisage de procéder à des licenciements, en raison des difficultés économiques qu’elle rencontre. Elle établit un plan de sauvegarde de l’emploi dans lequel elle prévoit de verser, aux salariés licenciés, 2 indemnités dont le montant dépendra de l’ancienneté du salarié :
- une indemnité de rupture supérieure à ce que prévoient la Loi et la convention collective qui lui est applicable ;
- une indemnité complémentaire « d’aide au projet personnel ».
Ces 2 indemnités sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le salarié concerné au cours des 12 derniers mois, sans préciser quelles sont les rémunérations visées. Ce qui suffit à une salariée pour contester le montant des indemnités qu’elle a perçues, à l’occasion de son licenciement économique.
Elle rappelle qu’une part de sa rémunération variable lui est versée sous forme d’option d’achat d’actions (stock-options), lesquelles sont soumises à une contribution sociale obligatoire. Selon elle, ces stock-options devraient donc être prises en compte dans le calcul de ses indemnités.
Mais ça n’est pas tout ! Elle souligne que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit que la participation et l’intéressement doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture. Ce qui n’a pas été le cas, s’agissant de son indemnité.
Choses normales, d’après le juge qui confirme le calcul de l’employeur. Il souligne que les attributions de stock-options ne constituent ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais uniquement un droit, pour le bénéficiaire, de lever ou non l’option. En outre, l’exclusion de la participation et de l’intéressement du calcul de son indemnité de rupture est justifiée parce qu’ils :
- ne sont pas soumis aux cotisations sociales ;
- ils ne sont pas expressément visés par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit des indemnités plus avantageuses pour le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-12473
Licenciement et indemnité : quelles rémunérations prendre en compte ? © Copyright WebLex – 2017
Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ?

La Loi pour une République Numérique prévoit que les communes de plus de 200 000 habitants puissent, sous certaines conditions, soumettre la location de logement via Airbnb à un enregistrement en Mairie. Encore faut-il que la Mairie vote la mise en place de cette procédure…
Airbnb : un enregistrement obligatoire dans certaines communes !
Comme l’y autorise la Loi, le Conseil de Paris, de même que les villes de Bordeaux et de Nice ont voté cet été la mise en place d’une procédure d’enregistrement pour toute personne qui souhaite louer temporairement un logement, notamment via la plateforme Airbnb. D’autres villes devraient mettre en place ce dispositif dans les semaines ou mois à venir.
Concrètement, toute personne mettant en location son logement sur des sites web de mises en relation avec des locataires (type Airbnb) doit s’enregistrer auprès de la Mairie. Pour se faire, elle doit recourir à une téléprocédure (accessible à compter du 1er octobre 2017 pour la ville de Paris par exemple), en précisant les informations suivantes :
- son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
- l’adresse du local meublé, en précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;
- le statut de résidence principale ou non du logement ;
- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
Dès réception de la déclaration par la Mairie, celle-ci doit délivrer sans délai un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration qui doit figurer sur l’annonce en ligne. Notez qu’une personne qui possède plusieurs logements mis en location doit procéder à une déclaration par logement.
Source : Délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 2017
Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ? © Copyright WebLex – 2017
