Conduire à l’étranger : avec quel permis ?

Espagne, Italie, Maroc, Russie, Australie, Etats-Unis, Mexique, Pérou, etc. Les destinations touristiques étrangères pour les vacances ne manquent évidemment pas. Pour vous déplacer, il se peut que vous preniez le volant. Mais pouvez-vous conduire une voiture en étant « seulement » titulaire du permis de conduire français ?
Conduire à l’étranger : 2 situations à distinguer !
L’administration française vient de rappeler les règles à connaître lorsque vous souhaitez conduire à l’étranger. 2 situations sont à distinguer :
- soit vous voyagez dans un pays de l’Espace économique européen : dans ce cas, votre permis de conduire français est valable, à condition bien sûr qu’il soit valide ;
- soit vous voyagez hors de l’Espace économique européen : dans ce cas votre permis de conduire français peut suffire dans certains pays ; toutefois, il peut être obligatoire, dans certains pays, que vous possédiez un permis de conduire international.
Pour déterminer si vous avez besoin ou non d’un permis international, rendez-vous sur le site Internet du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr). Il vous suffira alors d’indiquer le nom du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. Vous saurez ainsi si l’obtention d’un permis international est nécessaire ou non (notez que certains pays ne reconnaissent pas le permis international : dans ce cas, vous devez demander une autorisation spéciale qui est obtenue dans le pays dans lequel vous voyagez).
Source :
- www.diplomatie.gouv.fr
- www.service-public.fr
Conduire à l’étranger : avec quel permis ? © Copyright WebLex – 2017
Earn out : une clause à rédiger avec précision !

Un couple vend sa société, le contrat prévoyant un complément de prix de 125 000 € en cas de bons résultats de la société durant l’exercice suivant. Estimant que les résultats ont été atteints, le couple réclame les 125 000 €. A tort selon l’acquéreur, qui fait une autre lecture du contrat de vente…
Attention aux clauses imprécises !
Un couple vend sa société. A cette occasion, la convention de vente des titres prévoit un prix initial payé tout de suite et un complément de prix de 125 000 €, cette somme étant placée sous séquestre (juridiquement, on parle de clause d’ « earn out » ou clause de révision de prix). Pour que le couple perçoive cette somme, il était nécessaire que la société réalise un chiffre d’affaires de 600 000 € l’année suivante. A défaut, la somme serait remise à l’acquéreur.
Au terme de l’exercice suivant, l’acquéreur a réclamé la remise de la somme, estimant que le chiffre d’affaires était « seulement » de 544 000 €. Ce qu’a contesté le couple : pour lui, le chiffre d’affaires était supérieur à 600 000 €. Il considère donc que les 125 000 € doivent lui revenir…
… à tort selon l’acquéreur : il rappelle qu’en additionnant le total des commandes, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et donc inférieur au seuil de 600 000 € convenu lors de la vente de la société. « Faux » répond le couple : pour lui, il faut également tenir compte des intentions de commandes formulées par les prospects, même si elles ne sont pas formalisées par écrit, un contrat pouvant être formé verbalement. Or, en tenant compte des intentions d’achats, le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 600 000 €. Le couple réclame donc l’application de la clause d’earn out et le versement des 125 000 €…
… à tort selon le juge : le contrat de vente signé entre le couple et l’acquéreur est, selon lui, imprécis et ambigu. Rien ne permet, en effet, de déterminer s’il faut tenir compte ou non des contrats verbaux. C’est donc souverainement qu’il interprète le contrat : selon lui, le chiffre d’affaires doit s’entendre du montant total des commandes fermes concrétisées par écrit. Dès lors, le chiffre d’affaires est de 544 000 € et le couple ne peut pas réclamer la perception des 125 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2017, n° 15-20368
Earn out : une clause à rédiger avec précision ! © Copyright WebLex – 2017
Construction immobilière : attention aux empiètements !

Un couple fait édifier une maison qui finalement empiète sur le terrain de ses voisins. Ces derniers réclament alors la destruction de la maison. Ce que refuse le couple, estimant que cette sanction est totalement disproportionnée. La maison va-t-elle être sauvée ?
Empiètement sur le terrain du voisin = démolition de la maison ?
Un couple décide de faire édifier une maison par une société de construction. Mais une fois la maison terminée, les voisins se rendent compte que la maison empiète sur leur terrain en divers endroits (un empiètement maximum de 52 cm est constaté). Mécontents, les voisins ont alors réclamé la démolition de la partie de la maison qui empiète sur leur terrain, à savoir le mur pignon.
Ce que refuse le couple : il explique que la démolition du mur pignon implique la démolition de l’ensemble de la maison. Dès lors, la sanction lui paraît disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins…
… à tort selon les voisins : pour eux, la démolition n’est pas une sanction disproportionnée au regard de l’atteinte à leur droit de propriété. Ce que confirme le juge !
Sachez que cette erreur d’implantation est survenue par la faute du géomètre chargé de procéder au bornage de la propriété du couple. Lors du bornage, il a, en effet, indiqué au constructeur une délimitation du terrain erronée, débordant sur celui des voisins. Parce que le constructeur ne s’est pas assuré que la surface du terrain sur lequel a été édifiée la maison était correcte, il a été condamné à indemniser le couple pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18890
Construire une maison sur le terrain de son voisin, une mauvaise idée ? © Copyright WebLex – 2017
« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vraiment ?

Parce que son permis de construire est illégal, un couple réclame des dédommagements auprès de la Mairie. Cette dernière refuse, rappelant qu’une transaction a été conclue, aux termes de laquelle le couple renonce à engager la moindre poursuite contre elle. Transaction toutefois nulle, selon le couple : pourquoi ?
Une transaction doit prévoir des concessions de chaque côté !
Un couple obtient un permis de construire d’une maison qu’il souhaite édifier sur le littoral. Mais une association de protection de l’environnement estime que le permis de construire est illégal car il ne respecte pas la « Loi littoral ». En justice, l’association obtient gain de cause.
Mécontent, le couple se retourne contre la Mairie, considérant que cette dernière a commis une faute en délivrant un permis illégal. Le couple réclame alors un dédommagement équivalent aux sommes déboursées avant qu’il ne stoppe les travaux. Dédommagement que refuse de payer la Mairie…
La Mairie rappelle qu’une transaction a été signée, aux termes de laquelle le couple s’est engagé à ne pas entamer d’action en justice à son encontre, ni à lui réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Dès lors, elle estime qu’elle n’a pas à dédommager le couple…
… à tort répond ce dernier pour qui une transaction suppose des contreparties de chaque côté. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la transaction prévoit seulement des contreparties à la charge du couple. Par conséquent, la transaction n’a, selon le couple, aucune valeur juridique. Il estime donc qu’il peut réclamer un dédommagement à la Mairie, celle-ci ayant commis une faute en lui délivrant un permis de construire illégal.
Ce que confirme le juge ! La transaction ne comprenant pas de concession de la Mairie, elle est nulle et ne peut pas être appliquée. Le couple peut donc tout à fait réclamer un dédommagement à la Mairie. Dédommagement que lui accorde le juge, mais en limitant toutefois les sommes réclamées par le couple. Il fait, en effet, remarquer que ce dernier a continué à faire effectuer des travaux alors que son avocat l’avait prévenu que le permis serait très certainement annulé. Dès lors, le couple ne peut pas être indemnisé pour toutes les sommes dépensées.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 22 juin 2017, n° 17NT00465
« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vraiment ? © Copyright WebLex – 2017
Le démembrement de propriété : « donner, c’est donner » ?

Pour réduire le montant des droits qui seront dus sur une succession future, il est possible de procéder à des donations de droits démembrés, c’est-à-dire de donner la nue-propriété d’un bien, le plus souvent à ses enfants, tout en s’en réservant l’usufruit. Toutefois, l’administration peut être amenée à remettre en cause cette opération au moment du calcul des droits de succession…
Pas de donation, pas de rectification !
Pour optimiser la transmission de son patrimoine immobilier, une personne a choisi de donner la nue-propriété de ses biens à ses petits-enfants et d’en conserver l’usufruit. Concrètement, elle conserve le droit de percevoir les revenus de ses biens, mais transmet le droit de disposer de ces mêmes biens à ses enfants. Malheureusement, cette personne décède moins de 3 mois après avoir consenti ce don !
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant des impôts payés au moment de la donation. Elle réclame donc un complément d’impôt, ce que conteste le nu-propriétaire, invoquant pour sa défense la « présomption légale de propriété ».
La présomption légale de propriété revient à considérer qu’un bien meuble ou immeuble, dont l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’utiliser le bien et, le cas échéant, d’en percevoir les revenus) appartient au défunt et la nue-propriété à ses héritiers potentiels (appelés « héritiers présomptifs »), doit entièrement faire partie de la succession de l’usufruitier pour le calcul des droits de succession, jusqu’à preuve du contraire, sauf à ce que la donation ait été consentie plus de 3 mois avant le décès par acte régulier.
Le nu-propriétaire considère donc que la présomption légale de propriété induit une présomption d’inexistence de la donation. Or, qui dit absence de donation, dit absence de droits de donation !
L’administration persiste : elle considère que cette présomption, purement fiscale, n’entraîne pas l’annulation rétroactive de l’acte de donation. Partant de là, elle est en droit de demander le paiement d’un complément d’impôt.
Faux rétorque le juge : la donation étant intervenue moins de 3 mois avant le décès de l’usufruitier, la présomption légale de propriété a vocation à s’appliquer, entraînant avec elle une présomption d’inexistence de l’acte de donation… sauf à ce que le nu-propriétaire apporte la preuve de la sincérité de l’opération réalisée. Ce qui n’était pas le cas ici !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n°15-14170
Le démembrement de propriété : « donner, c’est donner » ? © Copyright WebLex – 2017
Vente d’un fonds de commerce : quand un créancier du vendeur apparaît…

Une société acquiert un fonds de commerce. Mais un créancier du vendeur va faire opposition au paiement du prix de vente, opposition que la société estime toutefois irrégulière : pourquoi ?
Vente d’un fonds de commerce : une opposition doit être régulière !
Une société acquiert un fonds de commerce et publie cette acquisition dans un journal d’annonces légales comme le prévoit la Loi. A la lecture de cet avis, un créancier du vendeur fait opposition au paiement du prix de vente. Opposition que l’acquéreur estime toutefois irrégulière…
L’acquéreur rappelle que l’opposition doit être faite à son domicile. Or, le créancier a formé son opposition chez un tiers. Dès lors, il considère que l’opposition est irrégulière. Ce que conteste le créancier : dans l’avis publié dans le journal d’annonces légales, il était précisé que les oppositions devaient être faites chez le tiers. Ce qu’il a fait.
Pour le juge, l’opposition doit être faite au domicile élu par l’acquéreur mentionné dans l’avis publié dans le journal d’annonces légales. L’acquéreur ayant indiqué que les oppositions seraient reçues chez le tiers, le créancier a donc eu raison de faire son opposition auprès de ce dernier. Par conséquent, son opposition n’est pas irrégulière.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2017, n° 16-11441
Vente d’un fonds de commerce : quand un créancier du vendeur apparaît… © Copyright WebLex – 2017
Insuffisance d’apport = faute ?

Un associé fait un apport dans sa société. Apport toutefois insuffisant estime un autre associé qui demande une indemnisation pour le préjudice subi. Ce que refuse le premier associé : pour lui, seule la société peut lui réclamer des dommages-intérêts. Qui a raison ?
L’insuffisance d’apport peut être un préjudice pour les autres associés !
Pour les besoins de développement d’une société, l’un des associés fait un apport de son activité de courtage en entreprises en échange de titres. Cet apport va faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer le montant et le nombre des titres reçu en échange de cet apport.
Toutefois, l’un des autres associés estime que le montant de cet apport est insuffisant au regard du prix de cession. Mécontent, il demande alors des dommages-intérêts au premier associé…
Dommages-intérêts que refuse de payer ce dernier, considérant que l’associé mécontent ne peut pas agir à son encontre. Pour lui, seule la société peut, en effet, être considérée comme « victime » en cas d’insuffisance d’apport, ce qui implique que seule cette dernière peut lui réclamer des indemnités.
Ce que conteste l’associé mécontent : l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause nécessairement un préjudice aux autres associés. Or, ce préjudice est, selon lui, distinct de celui que subit la société. Dès lors, il estime que sa demande de dommages-intérêts, fondée sur le préjudice qu’il a subi et non sur celui dont est victime la société, est tout à fait légitime. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 15-28091
Insuffisance d’apport = faute ? © Copyright WebLex – 2017
Démarchage téléphonique : une réclamation possible !
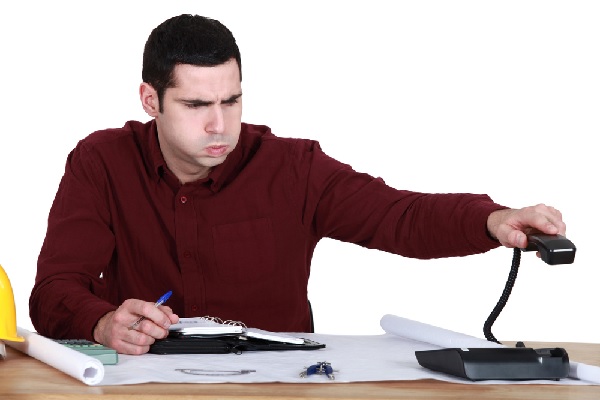
Il peut arriver que malgré votre inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, vous fassiez quand même l’objet de prospection commerciale. Dans ce cas, il existe des démarches pour empêcher le démarchage. C’est ce que vient de rappeler le Gouvernement…
Auprès de qui faut-il faire une réclamation ?
Saisi par un député sur la question des démarchages téléphoniques, le Gouvernement a rappelé qu’il est interdit à un professionnel, sous peine d’amende, de démarcher par téléphone une personne inscrite sur la liste d’opposition au démarchage téléphone (il s’agit de Bloctel) et avec laquelle il n’a pas de relations contractuelles en cours.
Toutefois, il arrive encore que des personnes inscrites sur Bloctel fassent l’objet d’un démarchage téléphonique. Si cela vous arrive, il faut effectuer une réclamation auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
La réclamation va permettre à la DGCCRF de mener une enquête pour constater les infractions et, le cas échéant, sanctionner les professionnels qui ne respectent pas la Loi.
Notez qu’en pratique, 2 types de démarchages illégaux existent :
- les appels téléphoniques relevant de la prospection commerciale en vue de vendre un produit ;
- les appels téléphoniques incitant le client à rappeler à un numéro surtaxé (c’est le « ping call »).
Cette 2ème pratique n’est pas concernée par le service Bloctel. Si cela vous arrive, vous devez signaler ce « spam vocal » en envoyant gratuitement un SMS au 33 700 en indiquant le numéro de téléphone litigieux par la formule « SPAM VOCAL 0X XX XX XX XX ».
Les opérateurs téléphoniques mèneront ensuite une enquête en lien avec la DGCCRF.
Source : Réponse Ministérielle Arribagé, Assemblée Nationale, du 9 mai 2017, n° 102387
Démarchage téléphonique : une réclamation possible ! © Copyright WebLex – 2017
Une exonération des cotisations sociales des indépendants ?

Certains travailleurs indépendants peuvent être exonérés de quelques-unes des cotisations sociales sous conditions de ressources. Un dispositif distinct s’applique aux travailleurs indépendants d’outre-mer et aux travailleurs indépendants de métropole…
Travailleurs indépendants de la métropole
Les travailleurs indépendants qui débutent leur activité doivent payer leurs cotisations sur une base forfaitaire, à titre provisionnel, les 2 premières années d’activité. Alors qu’auparavant, la base forfaitaire changeait entre la 1ère et la 2ème année, désormais, le taux de cotisation applicable de la 2ème année est le même que pour la 1ère année.
Attention ! Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, étant entendu que le changement de lieu d’exercice de l’activité indépendante n’est pas un début d’activité.
En outre, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction de cotisations sociales afférant au régime d’assurance maladie et de maternité si leurs revenus sont d’un montant inférieur à 27 459,60 €, soit 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale en 2017 (PASS).
Le taux de cotisation pour des revenus inférieurs à ce montant est progressif. Il se calcule selon la formule suivante :
Montant des cotisations = 6,50 % – 3,50 % × (1 – montant du revenu professionnel ÷ 0,7 × PASS)
Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.
Travailleurs indépendants d’outre-mer
Les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) bénéficiaient, avant le 1er janvier 2017, d’une exonération totale de leurs cotisations sociales pendant leurs 2 premières années d’activité.
Pour les travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, cette exonération est soumise à une condition de revenus :
- pour les revenus annuels inférieurs à 43 150,80 € en 2017 (110 % du PASS), l’exonération est de 100 % ;
- pour des revenus compris entre 43 150,80 € et 58 842 € (150 % du PASS), l’exonération correspondra à celui applicable à un revenu égal à 110 % du PASS ;
- pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 € (250 % du PASS), l’exonération sera dégressive pour s’annuler lorsque les revenus atteindront 98 070 €.
En outre, à partir du 1er janvier 2018, les revenus d’activité de la 3ème année bénéficieront d’un abattement de 75 % et ceux de la 4ème année de 50 %. L’abattement s’appliquera intégralement si les revenus sont inférieurs à 150 % du PASS (soit 58 842 € en 2017). Entre 150 % et 250 % du PASS, il sera dégressif.
Le taux de cotisation pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 €, se calcule selon la formule suivante :
Montant des cotisations = E÷39 228 × (98 070 – montant du revenu professionnel)
E représente le montant total de l’exonération calculée pour un revenu d’activité égal à 58 842 €.
Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à 13 % du PASS, les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer sont exonérés des cotisations d’assurance maladie.
Ceux dont les revenus d’activité ne dépassent pas 390 € sont exonérés de cotisation d’assurance vieillesse.
Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.
Source :
- Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, articles 1 et 3
Une exonération des cotisations sociales des indépendants ? © Copyright WebLex – 2017
Revenus fonciers : une déduction spéciale, sous conditions…

Le dispositif Cosse ancien instaure un avantage fiscal au profit des propriétaires qui louent leurs biens à des tarifs abordables dans le cadre de conventions passées avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Dispositif qui nécessite de respecter des conditions, notamment des plafonds de loyers et de ressources du locataire, dont les montants viennent d’être publiés…
Cosse ancien : les plafonds de loyers viennent d’être publiés.
Pour rappel, le dispositif Cosse ancien est destiné à remplacer progressivement les dispositifs Borloo ancien et Besson.
Pour bénéficier du dispositif, le propriétaire d’un bien immobilier devra respecter un plafond de loyer mensuel par mètre carré.
Pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2017, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur intermédiaire en métropole :
- ○ 16,83 € dans les zones A bis ;
- ○ 12,50 € dans les zones A ;
- ○ 10,07 € dans les zones B1 ;
- ○ 8,75 € dans les zones B2 et C.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 10,14€.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur social :
- ○ 11,77 € dans les zones A bis ;
- ○ 9,06 € dans les zones A ;
- ○ 7,80 € dans les zones B1 ;
- ○ 7,49 € dans les zones B2 ;
- ○ 6,95 € dans les zones C.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur très social :
- ○ 9,16 € dans les zones A bis ;
- ○ 7,05 € dans les zones A ;
- ○ 6,07 € dans les zones B1 ;
- ○ 5,82 € dans les zones B2 ;
- ○ 5,40 € dans les zones C.
Cosse ancien : les plafonds de ressources des locataires viennent d’être publiés
Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont identiques à ceux applicables dans le cadre du dispositif Borloo ancien.
Source : Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Revenus fonciers : une déduction spéciale, sous conditions… © Copyright WebLex – 2017
